/ REVUE / Nº 11 - LE CACA
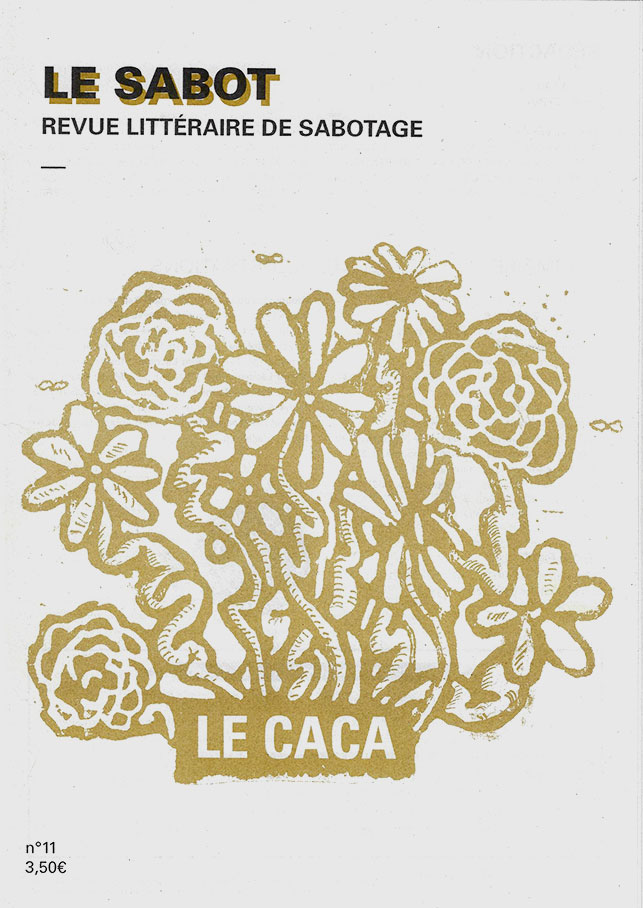
Numéro 11 - LE CACA / Juin 2021
︎Édito
Le trou
–
SABOTOn a creusé un trou hier. À plusieurs, dans un bois. On avait des pelles et notre sueur. Une simple prévoyance. Creuser la terre. Profiter de ses endroits meules. Rompre des racines. Trouver son humidité et ses vers. Lutter contre sa dureté, ses cailloux, notre fatigue. C’était dans le nord. Dans un bois du Nord, entouré de champs et de purin. On avait vu, pas bien loin, des cimetières militaires pour les poilus américains et canadiens. On s’est demandé Où ont pu passer les cadavres des Allemands. On s’est répondu C’est probablement une question de géopolitique et de mémoire : l’Allemagne n’entretient pas de cimetière dans le coin alors que les Américains payent des jardiniers et un souvenir d’héroïsme. On avait vu, pas bien loin, d’anciens trous d’obus. On creusait en se demandant sur quoi on allait tomber : une bombe ancienne et encore active ? Un fémur calciné ? La racine d’un arbre épais ? Mais on ne trouvait que de la terre et son lent travail de digestion organique. On creusait le trou parce qu’il fallait participer au lent et immense travail de digestion organique. On a creusé ce trou parce qu’on était prévoyants.
Dans les rues de la ville, je déambule. Soudain, l’envie est là, l’universelle démangeaison. C’est le moment de m’isoler, de céder à la pulsion organique et d’organiser ma solitude. Mais je suis loin du bois et loin de chez moi. Hier, nous étions nombreux pour construire de belles toilettes avec des portes anciennes, des couleurs vives, quelques palettes, une fosse à caca et un cadre bucolique. L’ensemble était sans doute légèrement rustique, mais maintenant, j’en perçois toute la richesse. Nulle part où aller. Le besoin monte et rend mes entrailles douloureuses. Des images de chiottes défilent alors que je traverse une foule dense, retrouvant l’esprit des chasseurs anciens, les yeux aux aguets et désespérés devant des toilettes publiques éternellement occupées ou closes : je rêve-éveillé des pires porcelaines de stations-service ; je ne me choquerais plus d’une entrée payante dans un parc parisien avec sa dame-pipi ou son tourniquet automatique ; je pense avec nostalgie au vieil abattant colorié de fleurs chez ma grand-mère, avec le bidet à côté, et à d’autres encore, imprimés de loups hurlant sous une lune chromée. Je revois les wc de l’école primaire, du collège, du lycée, des boulots ; les chiottes de bars sur les murs desquels on découvrait toute une archéologie d’ivresses… J’irai n’importe où ! Un café tout simple et étroit m’irait très bien, mais ils sont tous fermés, et je déambule en maudissant les privilégiés qui m’entourent. Tous ceux qui ont pu chier tranquille, qui savent déjà où ils iront lorsque l’envie viendra, ou pire : qui font caca sans conséquence parce que c’est une affaire qui ne les concerne pas – parce qu’il n’existe pas de balai à chiottes dans les chambres des hôtels de luxe et que c’est pour eux que les « agents de propreté et d’hygiène » travaillent à des heures invisibles. Là est l’origine des salaires de merde et de la croyance que la souillure des un∙es est nécessaire en ce qu’elle permet la survie des autres : les traces que je laisse seront effacées par un toujours moins riche que moi. Mais le caca c’est comme la confiture, plus on en a, plus on l’étale.
Alors la panique me prend. Une haine sourde me suit. Moi aussi je veux occuper un espace d’aisance où je caresserais ma précieuse solitude, nullement dérangé. Dire à quel point « c’est occupé » si l’on vient à taper à la porte. Être occupé, profondément occupé. Retrouver un semblant de position fœtale, entrer en méditation, chercher mon os et l’expulser. J’y passerais un temps bref ou infini, peu importe : l’espace-temps m’appartiendrait. Balek des autres et de l’autour. J’ai trop souvent été perturbé par une famille nombreuse, un internat bruyant, une colocation abondante, une banlieue gigantesque. Désormais, je veux m’isoler pour entrer en dialogue avec un essentiel : mon corps. Mais où aller !? Ma position devient critique et je marche toujours plus vite pour l’anesthésier. Le souvenir de situations-limites lors de défécations tragiques, racontées ou vécues, me submerge : des symptômes malades d’apocalypses, des humiliations traumatiques, des milliers de sous-vêtements jetés (par la fenêtre, dans des cuvettes, sous un buisson), des sauces décidément bien trop épicées, des chasses d’eau pathétiquement inopérantes, des portables souillés au pire moment, des déjections animales retrouvées dans des coins-surprises, un éventail incroyable d’angoisses totales devant l’urgence de faire, ou ne pas faire, caca…
Et je repense au bois, au trou et là, au cœur de la métropole, la rage me prend : pourquoi ce besoin de solitude ? Pourquoi continuer à me cacher, à embrasser une humiliation hygiéniste !? Je rythme ma respiration, écoute mon ventre. Je sais qu’il y a là un système neuronal fantastique à qui l’on doit notre bonne ou mauvaise santé mentale et émotionnelle. Toute ma frustration et ma colère proviennent précisément du gouffre viscéral qui se creuse dans mon bide. Peut-être que le seul moyen de retrouver une tranquillité d’esprit serait d’assumer ces intestins pleins et retourner la honte à cette foule qui m’impose son regard. Je pourrais me chier dessus simplement pour qu’ils me regardent bien, qu’ils me considèrent. Je profiterais d’être au centre de leur attention pour crier quelque chose de fondamental. Faire un hommage retentissant aux grèves de l’hygiène des prisonniers politiques de l’IRA. En profiter pour étaler ma merde sur tout ce qui me dégoûte. Avoir un caca contestataire. Savoir que je suis un cacatov en puissance… que nous sommes toutes et tous des cacatovs en puissance !
Je ferme les yeux et me retrouve dans le bois. Je sens l’ombre des arbres et le vent dans leurs branches. L’odeur de purin du champ voisin, mêlé aux parfums des herbes diverses m’emplit les poumons. C’est frais et agréable. J’ai ralenti le rythme de ma marche. Des brindilles craquent sous mon poids et j’évite d’écraser les fleurs sauvages. Ma digestion arrive à son terme. L’alchimie est complète et déjà je pense au prochain repas qui m’attend. J’ai retrouvé le trou creusé à la sueur de plusieurs fronts. Nous avons été si prévoyants ! Quelques vers gigotent dans le fonds. Je baisse mon pantalon. Mon attention est désormais précise et experte. J’inspire avec sérénité.
Ça soulage.